Bien le bonjour, jeunes littérophiles !
Je vais tâcher de vous entretenir de La Route de Cormac McCarthy : roman à succès, gagnant du prix Pulitzer et adapté au cinéma avec Viggo Mortensen. Pour être honnête, je ne pense pas que je l’aurais lu si deux amis à moi, dont je respecte particulièrement l’esprit critique, ne me l’avaient conseillé.
Le premier[1] m’avait vanté le côté glauque et amoral de l’histoire tandis que la deuxième m’en avait plutôt loué le style sans égal. Bref, j’attaquais le livre avec un a priori très positif.
L’histoire est relativement simple : un père et son fils marchent vers le sud. Le pays, et probablement le monde entier, a été dévasté par une catastrophe incendiaire. Il ne reste que quelques survivants qui, dans le meilleur des cas, s’entretuent pour les dernières boites de conserve et les ultimes outils qui sont utilisables. Entre épuisement et inanition, les deux personnages (qui n’ont pas de nom, seulement « l’homme » et « le petit ») avancent lentement sur la route.
Effectivement, le style est très étrange : une idée par phrase, jamais de descriptions longues ou complexes, un vocabulaire simplifié au maximum, etc. Cela rappelle un peu le nouveau roman, mais sans en être. Il faut avouer que ce style d’écriture, anémique, a quelque chose de fascinant, d’enlevant : on a la sensation que le narrateur, tout aussi exsangue que ses personnages, est sur le point de flancher lui aussi. Par contre, il faut confesser qu’au sortir de l’île du jour d’avant de Umberto Eco, la rupture stylistique a été très intense : passer du phrasé baroque à un texte écrit à bout de souffle, c’est un exercice de souplesse plutôt intense. Donc après un petit temps d’adaptation, cette manière d’écrire devient particulièrement efficace et je dois même avouer avoir fini par ne plus vraiment y prêter attention. Mais globalement, ce style renforce la sensation de lassitude, d’épuisement, de marasme dans lequel baignent les personnages.
Il faut ajouter à tout cela des dialogues lunaires, rares et expéditifs : les personnages comptent leurs mots, n’utilisent leur salive qu’avec parcimonie et semblent tellement habitués à l’horreur ambiante qu’ils ne s’offusquent que des cas cauchemardesques les plus violents. J’ai énormément aimé cette manière de conduire les dialogues, car, subtilement, on sent la réalité des personnages dans les rares moments où ils parlent. Autant les descriptions sont avares de réelles indications sur leur état psychologique, autant les dialogues sont des moyens d’accéder à leur réalité. Par exemple, plus le roman avance, plus on se rend compte que le petit essaye de parler comme sont père et qu’il tente de singer son rapport au monde malgré ses yeux d’enfants.
Ajoutons une traduction de très bonne facture, transparente et efficace. À ce que j’ai pu lire à droite et à gauche, la traduction est très fidèle au style de l’auteur.
La forme étant vue, passons au fond du roman.
L’histoire est très dure, et certaines scènes sont difficilement soutenables de barbarie. Les hommes sont ravalés au statut d’animaux sanguinaires et, la plupart du temps anthropophages, ou, pour les moins forts à de la vermine charognarde qui vit dans le sillage des prédateurs. Il semble que seuls les deux personnages principaux aient conservé un semblant d’humanité. Ils doivent cependant vivre comme des cafards, fouillant systématiquement les ordures, se terrant dans la boue au moindre bruit suspect, etc.
La violence ambiante est décrite de façon laconique dans ce style chancelant, dont je faisais état plus haut, et renforce encore l’horreur : de bébé à la broche aux prisonniers que l’on garde en vie pour les dévorer petit à petit et ainsi éviter la détérioration de la qualité de la viande, le roman pousse souvent le lecteur dans ses retranchements. Imaginez surtout le dialogue qui peut suivre : comment un père peut-il maintenir le gout de vivre d’un enfant dans de telles conditions ?
Mais la violence des hommes est peut-être moins angoissante que la désolation uniforme dans laquelle les personnages avancent à longueur de pages. Tout est gris, pareillement brulé et glacé. Le soleil n’est plus qu’un faible halo de lumière, il pleut un jour sur deux, le reste du temps la suie, les cendres en suspension rendent la respiration impossible sans masque. On ne reconnait pas le pays, difficilement la saison. Les arbres volent en poussière quand ils les touchent, les villes sont vidées de vie, parfois, un tireur embusqué se cache dans les décombres d’un immeuble éventré, pas d’animaux. Ils ne tombent jamais sur une pousse d’arbre ou sur un végétal qui aurait survécu. Tout est stérile, désolé et gelé. Fondamentalement, je trouve cet abandon de la nature bien plus violent que la représentation de la dépravation de l’humanité.
(Attention, cette partie révèle des éléments de l’intrigue, voire la fin du livre, qui, pour moi, mérite une attention particulière, et pourrait être une bonne manière à débat. Je ne suis pas un dangereux sadique, j’ai mes raisons de livrer la fin !)
Ajoutez à cela que dès les premières pages, on apprend que l’homme est malade et que, toutes les nuits, il se lève pour tousser du sang, que la mère s’est suicidée devant le père et que personne n’a véritablement de but et le roman devient quasiment insoutenable de pathos.
Et c’est probablement cela qui m’a profondément déplu dans La Route : trop de pathos pour être honnête ! La déconstruction systématique de la moindre forme d’espoir du lecteur est un jeu à double tranchant : elle pousse le lecteur à continuer autant qu’elle l’écoeure du monde du roman. C’est plutot le deuxième cas qui s’est appliqué à moi : j’ai aimé le fond, la forme, mais pas le projet du livre. Pour être exact, j’avais un sentiment plutôt négatif en le lisant, mais j’attendais la fin pour voir si l’auteur serait à la hauteur de ses ambitions.
Effectivement, plus on avance, plus la mort du père semble inévitable. Il finit par tomber malade et agonise sur vingt pages, fait des adieux déchirants à son fils et meurt en lui faisait un ultime câlin et en lui faisant promettre de continuer pour tenter sa chance, que Dieu ne l’abandonnera pas… Déjà, ce genre de passage qui force la larmichette me semble digne des téléromans « Faits vécus » qui passent sur M6 le midi (où vous verrez le combat d’une mère monoparentale dépressive cancéreuse et sans emploi face à la mort de sa mère dans un accident de ski nautique et à la leucémie en phase terminale de son fils adoptif pendant que son propriétaire, sadique, veut l’expulser pour manquements aux loyers et que les usuriers de son ex-mari, qu’elle aime encore, lui envoient régulièrement des phalanges parce qu’il a laissé des dettes de jeux qu’il ne peut payer, car il couche avec sa belle soeur qui ignore qu’elle est séropositive…). Bref, trop de pathos tue le pathos.
Donc voila notre petit enfant seul face au monde, cinq pages avant la fin, avec un pistolet à une seule balle, pas de couvertures, pas de vivres. Si on continue la logique du roman, il devrait se faire dévorer, tuer et violer (dans l’ordre de votre choix) dans les quarante huit prochaines heures. Eh bien non ! Un mec sympa arrive de nulle part et lui propose de venir vivre heureux avec sa famille (il a une femme et deux enfants) ! Ils enterrent le père et partent ensemble, bras dessus, bras dessous, en se faisant la promesse de ne jamais oublier… blablabla, j’arrête là, j’ai mal au coeur.
La fin désavoue tout le reste du bouquin est c’est bien dommage ! Tout est bon, le style, le fond, la forme, la relation entre les personnages… seulement voilà, le pathétique prend le dessus au fur et à mesure que l’histoire avance pour finir dans une apothéose de mièvrerie, histoire que les lecteurs ne passent pas un trop sale été sur les plages et soient capables de vivre avec ce roman sur la conscience, et c’est exactement ce qui me chicotait pendant ma lecture. Je veux croire que le roman aurait été bien plus fort avec une fin plus dure. Du coup, La Route reste, pour moi, dans la catégorie « Livre d’été » … Le DaVinci Code (D, Brown) est au Pendule de Foucault (U. Eco) ce qu’est La route à Parasite(Ruy Murakami)…
[1] Dont vous trouverez une critique en suivant ce lien : http://codexgnouf.canalblog.com/tag/Chassegnouf/p10-0.html)
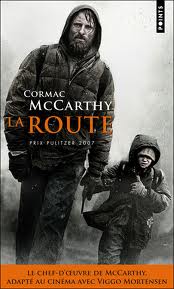
Perso j’ai pas trouvé qu’il y avait trop de pathos mais j’ai eu le sentiment que leurs emmerdes étaient justement dans l’ordre des choses. L’auteur a suffisamment bien travaillé pour nous convaincre que son monde était sans espoir et j’en suis venu à penser qu’il n’y avait que 2 fins possibles, une fin rapide plus ou moins expéditive et une agonie d’autant plus lente qu’on se bat pour survivre. Souvent, au cinéma ou dans la littérature (ou dans les BD) on nous dépeint des mondes post-apocalyptiques où la civilisation tente de survivre et de se reconstruire avec plus ou moins de succès, où le nombre est encore synonyme de cohésion et d’espoir. Là c’est un post-post-apocalyptique, les espoirs précédents se sont effondrés, les communautés de survie ont implosé face aux manques de ressources dans ce monde si mort, si minéral.
Je me suis interrogé sur la pertinence d’une telle succession de malheurs et finalement, je n’ai eu qu’à regarder la réalité (camps de prisonniers divers, boat people, famines diverses présentes et passées, les soldes, le jeu Hordes, etc.) pour me rendre compte que le monde et l’histoire de McCarthy sont dans le vrai. Sans ressources, nous nous boufferons les uns les autres une fois que les premiers à tenir les flingues seront réduits au silence.
De ça, MacCarthy m’a convaincu. Et avec ça en tête, j’ai trouvé la fin on ne peut plus douteuse. Est-ce que les sauveurs de la fin ne sont pas gentils pour amadouer le petit ? C’est encore plus pratique si le futur steak marche tout seul à côté de nous… Puis même s’ils sont sincères, le père de famille sera bientôt à court de munitions, les eaux ne sont pas plus poissonneuses, la végétation ne pousse toujours pas, un jour où l’autre, ils crèveront de faim et au mieux, ils agoniseront plus lentement que le père du petit, au pire, ils devront faire un choix entre sauver leur gosse et celui qu’ils ont récupéré sur la route.
Je comprends ton point. Ton argument du post-post apocalyptique est bon et explique beaucoup de choses. Cependant, compte tenu que le père ait connu le changement, et qu’il me semble que la procréation de l’enfant date d’avant l’apocalypse, je n’arrive pas à y adhérer à 100%. Je trouve ca trop rapide pour qu’il ne reste plus de communauté de survie.
Mais de toute évidence, le livre a beaucoup plus frappé ton imaginaire que le mien : je confesse ne pas avoir su tirer quoique soit d’autre de cette histoire . As tu lu World War Z de Max Brooks ? C’est, pour moi, un des romans post apocalyptique les mieux fait que je n’ai jamais lu ! Du coup, celui ci ne me semble qu’une très pâle copie et n’arrive pas à titiller mon imaginaire.
Au tout début, je voulais montrer que le roman était centripède (tout pointe vers lui) et que normalement les romans sont plutot centrifuges (ils sont une portion d’un monde plus vaste). J’ai laissé tomber cet axe car il était un peu casse gueule. En te lisant, je me dis que j’ai bien fait : ton imaginaire comble des trous que le mien déplore, du coup ta lecture est plus centrifuge que la mienne….
Mais toi, est ce que ca ne te dérange pas de ne pas connaitre la nature de cette apocalypse ? Pendant tout le roman, je n’ai pas pu me sortir ca de la tête. Rien de connu ne fonctionne et ca m’a perturbé profondément. Pas toi ?
Pendant tout le récit, j’ai essayé de deviner ce que c’était que cette catastrophe. Au début, ça m’a titillé puis je me suis dit que c’était pas le sujet, qu’il fallait se recentrer sur le récit plutôt que « s’évader » et refaire la catastrophe dans son esprit comme on va voir le film 2012. Je crois que c’est un outil qui va bien avec le style du bouquin : c’est le passé, ça change rien, le danger est proche, il faut rester concentrer.
Je pense que tu es bien plus dans le vrai que moi finalement : ta manière de comprendre le livre me semble plus « naturelle » que la mienne, elle rend plus justice au livre et à sa « philosophie ».
À mon avis, je suis resté trop proche de la règle de vraisemblance et cela a nuit grandement à l’appréciation générale de l’histoire.
Ceci dit, ton souci de la vraisemblance m’a donné envie de lire World War Z ^^
D’ailleurs, rien à voir mais j’ai le pendule de foucault et l’ile du jour d’avant dans un carton, vais devoir les ressortir
J’ai bien hâte de te lire à ce sujet ! Donne nous des nouvelles de tes lectures, c’est toujours intéressant, et même si tu ne vises pas de nous le faire lire, rien que le fait d’en parler peut nous ouvrir à quelque chose d’autre ….
Je viens de finir le livre, et je tombe par hasard chez toi.
Je ne laisse que rarement des commentaires sur les différents blogs que je suis.
Mais ce livre m’a tellement remué, que je souhaite apporter ce soir ma vision.
Quand l’enfant voit un autre enfant dans une des villes qu’ils traversent. Ne penses tu pas qu’il s’agit de l’enfant dont le « sauveur » parle. D’ailleurs ce sauveur dit qu’ils ont longtemps hésité avant de se décider à venir les voir.
Je trouve qu’il s’agit d’une fin plutôt optimiste, oui, bien sur la terre ne produit plus rien… mais j’aurais tendance à dire pour l’instant…
Cette fin, ouverte, laisse place à pas mal d’interprétation et la votre est probablement aussi juste que la mienne. Cependant, je n’ai pas ressenti d’optimisme dans cette fin, probablement parce que pour pouvoir extrapoler quelque chose de positif il aurait fallu que les personnages tombent au moins une fois sur quelqu’un de minimalement sympa, sur une situation qui laisse entrevoir qu’il peut y avoir du mieux. Du coup, j’ai tendance à croire qu’en cas de coup dur, cette « nouvelle famille » se délestera du nouvel arrivant sans trop d’encombre moraux. C’Est à date, la logique du bouquin, et je n’ai pas saisi d’indices qui puisse me faire douter de la pérennité de cet ordre des choses…
Ce qui serait intéressant, serait de savoir d’où vous provient cette sensation que la fin n’est pas fondamentalement pessimiste.
Hello Julien, Bonjour Barbara,
Des années après avoir lu le livre, je me demande finalement si l’auteur ne s’efforçait pas de nous immerger, nous lecteurs, dans cette scène pour que nous apportions nous même cette touche finale, la réponse (pessimiste ou optimiste) à cette question « Et après ? Les champs dévastés font-ils finalement se couvrir de fleurs ou le garçon va-t-il finir en kebab ? ». Sommes-nous l’homme paranoïaque ou l’enfant innocent ?
Peut-être est-ce ma nature, notre nature profonde à tous, qui rejaillit en lisant ce livre, et ceci sans que l’auteur cherche à nous changer.
Les pessimistes le resteront, et les optimistes, trouveront des détails, des mots, des phrases, des lueurs d’espoir dans l’horreur traversée par ces deux êtres.
Peut-être que si je reprenais le livre en analysant phrases après phrases, je ne les retrouverais pas. Pourtant au moment ou j’ai fermé le livre je me suis dis : il est sauvé, c’est en parti la fin de son calvaire. J’ai tout de suite imaginé que cet enfant et la petite fille dont parle « le sauveur » allait pouvoir faire des enfants, et la vie se perpétuer. Bien entendu difficilement au début, puis de plus en plus facilement.
L’enfant porte le feu…